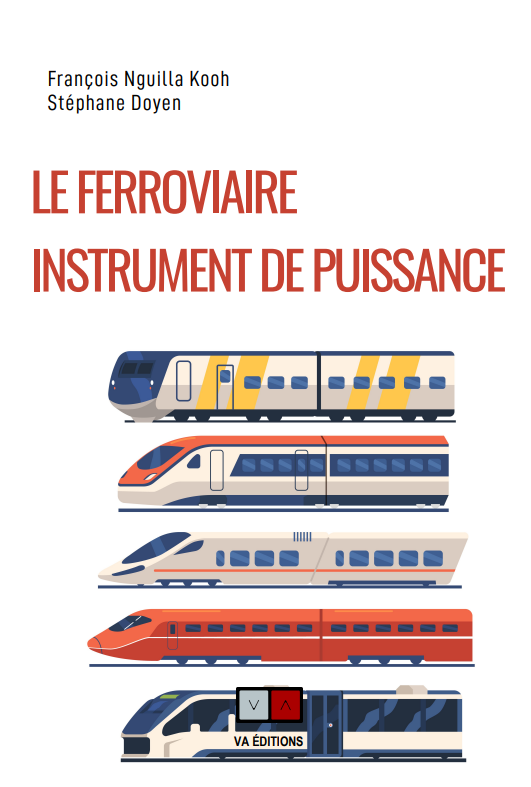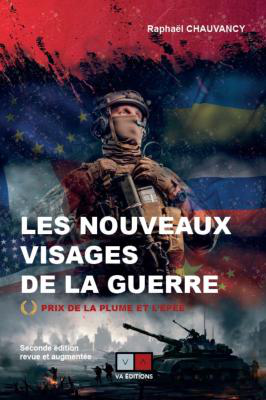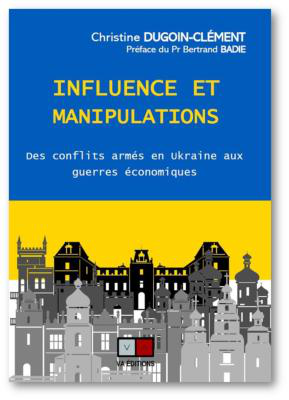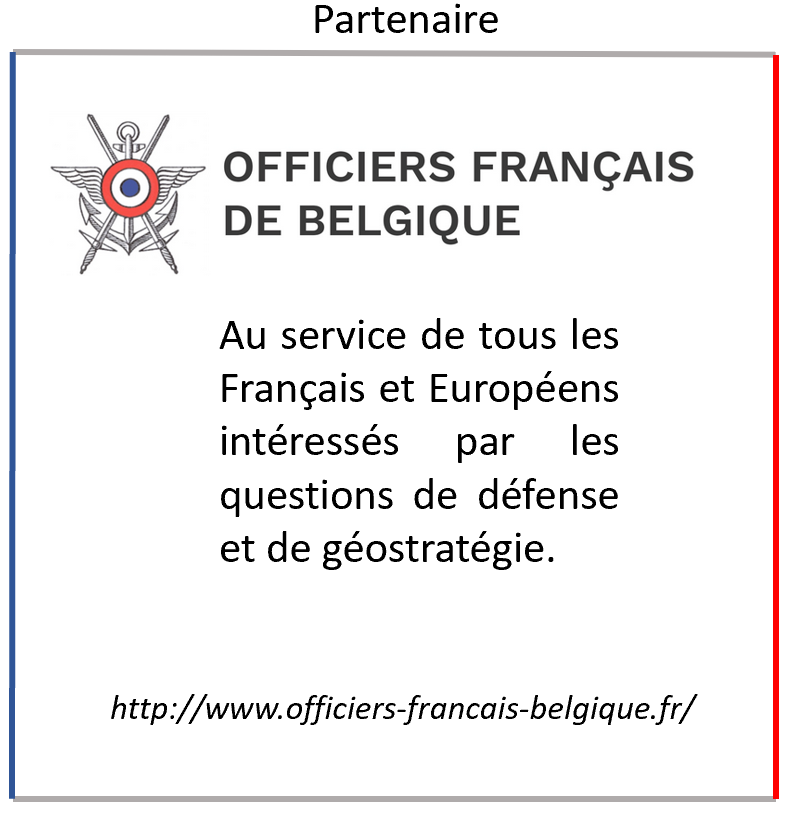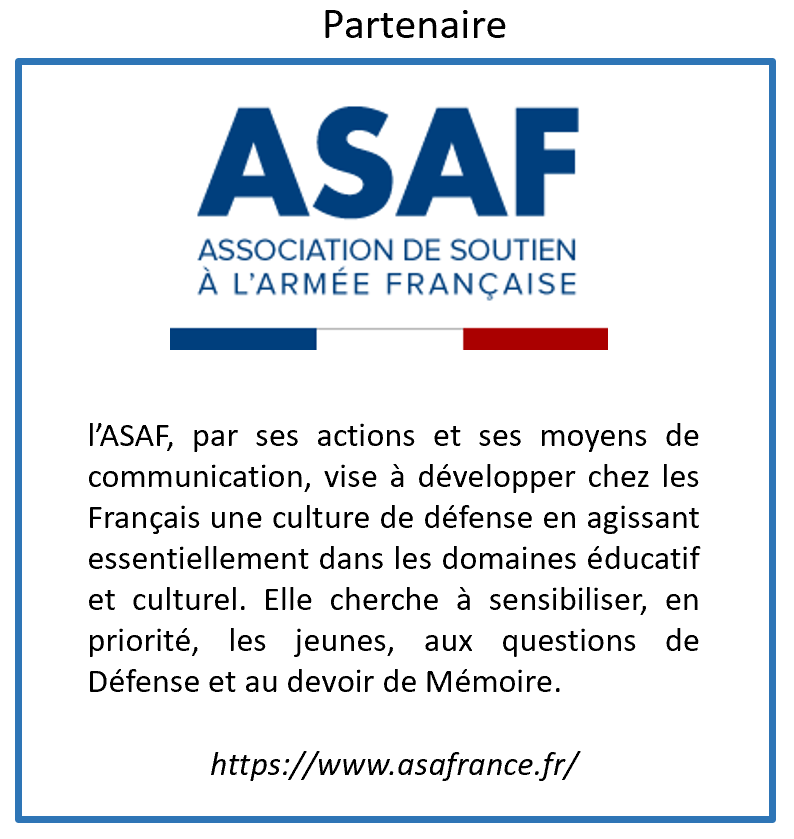PFAS : une interdiction qui dépasse le cadre français
Utilisés dans des secteurs aussi stratégiques que l’aéronautique, l'électronique, le médical ou encore la défense, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) font l’objet d’une surveillance depuis plusieurs années. Leur persistance environnementale et des études inquiétantes sur leurs effets potentiels sur la santé ont conduit à des appels à restriction.
Bruxelles prépare une réglementation harmonisée via l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui pourrait aboutir à un encadrement strict d’ici à 2027. Mais Paris prend les devants en annonçant une interdiction massive, bien avant cette échéance, par le biais d’une proposition de loi déposée par le député Nicolas Thierry. Ce choix unilatéral place la France dans une posture de précurseur, mais expose aussi son industrie à des risques concurrentiels majeurs.
Bruxelles prépare une réglementation harmonisée via l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui pourrait aboutir à un encadrement strict d’ici à 2027. Mais Paris prend les devants en annonçant une interdiction massive, bien avant cette échéance, par le biais d’une proposition de loi déposée par le député Nicolas Thierry. Ce choix unilatéral place la France dans une posture de précurseur, mais expose aussi son industrie à des risques concurrentiels majeurs.
Un levier économique sous couvert d’enjeu environnemental
Derrière cette croisade réglementaire se cache une bataille d’influence économique. La Suède, en pointe sur la question des restrictions chimiques en Europe, milite depuis près de vingt ans pour un encadrement plus strict des PFAS. Le pays, dont l’industrie chimique est moins développée que celle de la France ou de l’Allemagne, voit dans cette interdiction un moyen de renforcer la compétitivité de ses entreprises sur un marché en mutation.
L’ECHA, très influencée par les régulateurs suédois et leurs alliés du Conseil nordique des ministres, préconise une restriction généralisée des PFAS, y compris ceux qui ne présentent pas de danger avéré. Cette approche radicale avantage les industriels nordiques qui ont anticipé la transition et fragilise les grandes puissances chimiques européennes.
Au cœur de ce dispositif, l’ONG ChemSec, financée en partie par Stockholm, joue un rôle central en mobilisant l’opinion publique et les institutions européennes contre ces substances. L’organisation bénéficie du soutien d’acteurs économiques comme Electrolux et IKEA, qui ont déjà adapté leurs chaînes d’approvisionnement.
L’ECHA, très influencée par les régulateurs suédois et leurs alliés du Conseil nordique des ministres, préconise une restriction généralisée des PFAS, y compris ceux qui ne présentent pas de danger avéré. Cette approche radicale avantage les industriels nordiques qui ont anticipé la transition et fragilise les grandes puissances chimiques européennes.
Au cœur de ce dispositif, l’ONG ChemSec, financée en partie par Stockholm, joue un rôle central en mobilisant l’opinion publique et les institutions européennes contre ces substances. L’organisation bénéficie du soutien d’acteurs économiques comme Electrolux et IKEA, qui ont déjà adapté leurs chaînes d’approvisionnement.
Un boulevard pour les industriels chinois et américains
En se plaçant en pointe sur ce dossier, la France risque de créer un effet d’aubaine pour ses concurrents internationaux. Les États-Unis, tout en renforçant progressivement leur réglementation, adoptent une approche plus pragmatique, avec des transitions longues et des mesures adaptées aux besoins des industriels. Et, surtout, laisse la réglementation dans les mains de chaque état fédéral.
La Chine, quant à elle, profite de régulations plus souples. Si certains PFAS les plus toxiques y sont encadrés, une multitude de dérivés restent largement produits et commercialisés. Une interdiction française brutale risquerait d’accroître la dépendance aux importations chinoises, avec des substances difficilement traçables.
La Chine, quant à elle, profite de régulations plus souples. Si certains PFAS les plus toxiques y sont encadrés, une multitude de dérivés restent largement produits et commercialisés. Une interdiction française brutale risquerait d’accroître la dépendance aux importations chinoises, avec des substances difficilement traçables.
Un impact industriel de grande ampleur
Les conséquences pour l’industrie hexagonale pourraient être lourdes. Dans l’aéronautique, les PFAS sont essentiels aux revêtement des moteurs et des composants électroniques. Leur interdiction risque de fragiliser les chaînes d’approvisionnement et de favoriser la délocalisation de certaines productions. L’industrie médicale repose également sur ces substances pour la fabrication de dispositifs comme les implants et les prothèses. Une interdiction non concertée pourrait renforcer la dépendance à l’Asie et aux États-Unis pour ces produits de haute technologie.
Enfin, dans l'électronique et les semi-conducteurs, les PFAS sont indispensables à la production de circuits imprimés et de microprocesseurs. Alors que l’Union européenne tente de relocaliser la fabrication de puces avec le Chips Act, la France pourrait paradoxalement affaiblir sa position dans cette compétition.
En agissant en solo, Paris prend aussi un risque juridique. Le principe de libre circulation des biens au sein de l’UE pourrait être invoqué par des industriels pour contester la mesure devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Des précédents existent : la CJUE a déjà suspendu des restrictions nationales jugées excessives.
La France gagnerait à privilégier une approche plus concertée. Plutôt qu’une interdiction brutale, un cadre réglementaire progressif, adossé à des investissements dans la recherche d’alternatives, permettrait de concilier protection environnementale et compétitivité industrielle. Dans cette course à la réglementation, l’Hexagone doit veiller à ne pas se piéger lui-même.
Enfin, dans l'électronique et les semi-conducteurs, les PFAS sont indispensables à la production de circuits imprimés et de microprocesseurs. Alors que l’Union européenne tente de relocaliser la fabrication de puces avec le Chips Act, la France pourrait paradoxalement affaiblir sa position dans cette compétition.
En agissant en solo, Paris prend aussi un risque juridique. Le principe de libre circulation des biens au sein de l’UE pourrait être invoqué par des industriels pour contester la mesure devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Des précédents existent : la CJUE a déjà suspendu des restrictions nationales jugées excessives.
La France gagnerait à privilégier une approche plus concertée. Plutôt qu’une interdiction brutale, un cadre réglementaire progressif, adossé à des investissements dans la recherche d’alternatives, permettrait de concilier protection environnementale et compétitivité industrielle. Dans cette course à la réglementation, l’Hexagone doit veiller à ne pas se piéger lui-même.

 Diplomatie
Diplomatie