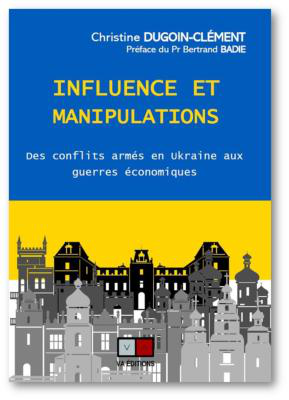Entretien avec Frédéric Charpier publié dans la Revue des affaires n°5
Votre ouvrage « L’économie, c’est la guerre » est le fruit d’un travail d’investigation sans précédent sur les coulisses de l’économie. En tant que spécialiste du renseignement, quel a été dans votre esprit le déclencheur de cette enquête ?
Deux enquêtes précédentes que j’avais réalisées ; l’une sur la CIA en France, et l’autre sur l’affaire des comptes falsifiés de la chambre de compassion luxembourgeoise Clearstream, qui attribuait des comptes en banque secrets à Nicolas Sarkozy. La première soulignait le poids des réseaux d’influence des Etats-Unis en France et le rôle de leurs services secrets, la seconde révélait indirectement - au-delà de l’opération politicienne - l’âpreté des combats souterrains qui minent le monde des affaires. En particulier celui des affaires sensibles comme l’armement et la haute technologie. Ces enquêtes montraient que nous avions des ennemis puissants et parfois acharnés, et que notre empire industriel vivait sous une menace constante.
Dans la première partie de votre ouvrage, vous dressez un panorama sans concession des relations franco-américaines, telles qu’elles s’opèrent en coulisses : rivalités, manipulations, impensables coups tordus en tous genres et, naturellement, représailles... Y’a-t-il une « diplomatie parallèle », à vos yeux, bien moins feutrée que celle qu’on daigne exhiber dans les médias ?
Les relations internationales sont évidemment bien plus « musclées » qu’on ne le croit, leur rudesse apparaît dès que vous passez de l’autre coté du miroir et que vous devenez, en quelque sorte, un initié. De ce côté de la réalité, on laisse tomber les salamalecs, on ne se fait pas de cadeaux, et si on peut prendre l’avantage - même sur un ami ou un allié ! - on ne s’en prive pas. Seul frein : le rapport de forces. On peut quasiment dire que tous les coups sont permis, et l’affaire Snowden l’a, d’une certaine façon, amplement démontré.
Pour autant, la France n’est pas la faible victime que certains Cassandre cherchent à dépeindre. Elle serait même réputée, notamment aux Etats-Unis, pour être particulièrement offensive, voire même redoutée, dans le domaine du renseignement économique…
Cela a été, en enquêtant, l’une de mes grandes surprises. Non seulement, la France n’a pas vocation à jouer les victimes mais, par le passé, elle a aussi fait preuve avec ses services d’une réelle audace, défiant sans crainte ni scrupule les grandes puissances et notamment les Etats-Unis. Ce n’est semble-t-il qu’une question de volonté politique. Quand cette volonté a existé (par exemple au début des années 80 puis au début des années 2000), elle a fait souffrir ses adversaires en s’emparant frauduleusement par exemple d’informations technologiques confidentielles, ou en faisant échouer certaines opérations hostiles à son « patrimoine » industriel stratégique. A-t-elle aujourd’hui encore cette pugnacité dans la recherche du renseignement ou pour contrer des offensives hostiles, je l’ignore.
Vous rapportez une anecdote stupéfiante. Au printemps 2010, Nicolas Sarkozy, alors Président de la République, aurait effectué un voyage éclair aux Etats-Unis afin de signer un accord secret visant à sceller, en présence de son homologue Barack Obama, un « pacte de non-espionnage réciproque ». Or, la France aurait essuyé ce jour-là un sérieux camouflet. Toujours pas de gentlemen’s agreement entre la CIA et la DGSE, donc ?
C’est vrai, Nicolas Sarkozy a cru que la France avec lui occupait une place privilégiée auprès de l’allié américain. Il s’est trompé. Sans doute s’est-il laissé abuser par ses conseillers spécialisés dans le Renseignement qui, eux-mêmes, ont sans doute manqué de réalisme et de sens politique, notamment en sous-estimant l’influence de la CIA et en pariant ingénument sur le coordinateur du renseignement américain. Cet homme n’était pas vraiment du sérail, et il était de surcroît à l’époque très controversé et engagé dans un bras de fer avec la CIA sur la question des opérations clandestines.
Par ailleurs la France n’entretient pas, comme la Grande Bretagne, de liens historiques intimes avec les services américains. Sur le fond, la situation n’a guère changé depuis. La France demeure certes un partenaire du premier rang mais elle n’a toujours pas un statut d’allié hors norme. Toutefois, dans le domaine de la « guerre technique » (écoutes, interceptions, intrusions, etc.), la DGSE et la NSA entretiennent aujourd’hui des relations qualifiées d’excellentes du fait, sans doute, que la France a accru ses « moyens techniques » et qu’elle aspire à jouer un rôle majeur dans la guerre du « renseignement électronique ».
Les guerres secrètes que vous décrivez ne se limitent pas au champ de l’espionnage. Leur autre versant serait la guerre d’influence que se livrent les nations et les grandes entreprises. Pouvez-vous nous citer un exemple permettant d’en cerner les enjeux ?
L’influence, c’est beaucoup de choses à la fois, un ensemble de mesures et de contre-mesures que l’on qualifie de « software ». Elle sert notamment à peser sur un choix ou une orientation, à influer dans une négociation ou encore à affaiblir son adversaire en le déstabilisant ou en le trompant. L’influence se marie souvent à des campagnes de presse, des opérations d’espionnage et d’écoutes classiques. Lorsqu’à Bruxelles, dans les années 90, les Américains ont contesté le concept « d’exception culturelle » afin de pousser leurs propres produits culturels sur le marché européen, les services français ont mené diverses opérations ayant pour but de dénoncer des alliances secrètes et cachées entre des hauts fonctionnaires et responsables politiques de l’Union européenne, et les représentants de l’industrie du spectacle américaine. En dénonçant ces connivences et la stratégie américaine, ils ont affaibli l’adversaire et ses actions de lobbying.
A la clé existait alors un enjeu commercial considérable. Souvenons-nous qu’avant la seconde guerre mondiale, le cinéma français représentait une énorme source de devises (et même une des principales) eu égard à son attractivité à l’étranger. L’influence c’est aussi faire capoter un contrat d’armement, en révélant par exemple dans la presse une opération de corruption que l’on a découverte par les moyens traditionnels de l’espionnage, et encore bien d’autres choses.
Le continent africain serait le théâtre d’une guerre d’influence acharnée entre la France et ses rivaux américain, israélien, chinois… Quelle est la réalité de la Françafrique, aujourd’hui ?
En termes de stricte influence, on peut dire que la « Françafrique » s’est contractée, ce qui signifie que nous sommes toujours très présents dans notre pré carré mais qu’il a fallu partager de gré ou de force avec d’autres concurrents, qui n’hésitent pas à contester les ressorts traditionnels de la « francophonie » et de ses réseaux.
Sur le plan militaire, inversement, en raison de la menace terroriste, notre présence - notamment celle des services secrets et des forces spéciales - s’est accrue d’autant que nos intérêts énergétiques (pétrole, gaz et uranium) dans la région exigent également une « protection » particulière et renforcée.
Le rôle croissant du secteur privé dans ces guerres souterraines a de quoi interpeller. Qui sont ces « privés » de la guerre économique ?
Vaste sujet… Disons que la sécurité privée et les officines de renseignement privées qui avaient le vent en poupe et pullulaient connaissent actuellement une situation de saturation et de concentration. Des groupes majeurs sont en train de se constituer, souvent sous l’égide de compagnies financières puissantes ou de grands groupes d’affaires. Elles emploient comme chacun sait d’anciens de la police, de la gendarmerie, des douanes ou encore des services secrets, et se sont structurées dans le cadre d’organisations professionnelles, objets de vigoureux enjeux de pouvoir, dont le top est le très influent et très côté « club des directeurs de sécurité des entreprises ».
Ces sociétés privées ne font pas ce qu’elles veulent. Officiellement, et par divers relais, elles sont toutes plus ou moins contrôlées ou surveillées par les services spéciaux français, DGSI et DGSE. Certaines d’entre elles peuvent malgré tout agir comme de simples officines.
A en croire l’issue de votre enquête, espions et manipulateurs sont aujourd’hui partout : fonds d’investissement, ONG, fondations, ambassades, grandes entreprises, centres de recherche… Est-il exagéré ou raisonnable de penser que tout interlocuteur est potentiellement un agent étranger?
Mon enquête a en effet révélé que l’ennemi, l’adversaire, le compétiteur résolu, qu’il s’agisse de très grandes entreprises ou d’Etats, ne recule devant aucun stratagème pour parvenir à ses fins. On sait, et pas seulement depuis la fuite de Snowden, que les agences de renseignement américaines ont violé les communications y compris les plus secrètes des autres Etats et même d’Etats alliés durant des décennies, grâce aux liens qu’elles entretenaient avec les grandes firmes de télécoms américaines ou encore grâce au système d’écoutes Echelon, créé au début de la guerre froide.
Des fonds d’investissement plus ou moins directement contrôlés par les services américains ont également racheté des sociétés aux activités sensibles. Par ce même canal, les services américains ont financé des recherches dans des domaines stratégiques comme celui des piles au lithium. Via le rachat de grandes compagnies d’assurances, les agences américaines, en faisant vibrer le patriotisme actionnarial des nouveaux propriétaires, ont pu faire discrètement main basse sur des banques de données phénoménales.
L’AID, l’agence américaine d’aide au développement, continue de servir de levier à la politique américaine dans les pays déshérités ou en voie de développement. Plusieurs rapports d’origines diverses ont établi le rôle plus qu’ambigu de certaines fondations ou ONG utilisées dans un rôle d’influence ou comme couverture pour des opérations de déstabilisation. N’oublions pas enfin cette incroyable directive d’Hilary Clinton, alors ministre des Affaires Etrangères de Barak Obama, datée du 31 juillet 2009 et adressée à la délégation diplomatique américaine à l’ONU. Hilary Clinton invitait ses membres à rassembler sur leurs collègues étrangers onusiens toutes sortes d’informations telles que leur ADN, leurs numéros de cartes de crédit ou bien les mots de passe de leur ordinateur, autant d’informations susceptibles d’être par la suite exploitées par les grandes agences de renseignement américaines.
D’après vous, qui avez tout de même rassemblé des milliers de documents secrets et avez interrogé bon nombre de ces acteurs clandestins de l’économie, quel sera le prochain pas franchi dans la guerre économique ?
Je ne lis pas dans le marc de café, mais on peut envisager une guerre des « clouds ». L’une des plus terribles hantises du monde financier serait en effet de voir disparaître les archives numériques des banques et autres institutions financières. On comprend aisément leur angoisse : quel système peut fonctionner sans mémoire ? Autre indiscutable maillon faible : le monde de l’Internet et ses « tuyaux », bien plus vulnérables qu’on ne le dit.
Votre ouvrage « L’économie, c’est la guerre » est le fruit d’un travail d’investigation sans précédent sur les coulisses de l’économie. En tant que spécialiste du renseignement, quel a été dans votre esprit le déclencheur de cette enquête ?
Deux enquêtes précédentes que j’avais réalisées ; l’une sur la CIA en France, et l’autre sur l’affaire des comptes falsifiés de la chambre de compassion luxembourgeoise Clearstream, qui attribuait des comptes en banque secrets à Nicolas Sarkozy. La première soulignait le poids des réseaux d’influence des Etats-Unis en France et le rôle de leurs services secrets, la seconde révélait indirectement - au-delà de l’opération politicienne - l’âpreté des combats souterrains qui minent le monde des affaires. En particulier celui des affaires sensibles comme l’armement et la haute technologie. Ces enquêtes montraient que nous avions des ennemis puissants et parfois acharnés, et que notre empire industriel vivait sous une menace constante.
Dans la première partie de votre ouvrage, vous dressez un panorama sans concession des relations franco-américaines, telles qu’elles s’opèrent en coulisses : rivalités, manipulations, impensables coups tordus en tous genres et, naturellement, représailles... Y’a-t-il une « diplomatie parallèle », à vos yeux, bien moins feutrée que celle qu’on daigne exhiber dans les médias ?
Les relations internationales sont évidemment bien plus « musclées » qu’on ne le croit, leur rudesse apparaît dès que vous passez de l’autre coté du miroir et que vous devenez, en quelque sorte, un initié. De ce côté de la réalité, on laisse tomber les salamalecs, on ne se fait pas de cadeaux, et si on peut prendre l’avantage - même sur un ami ou un allié ! - on ne s’en prive pas. Seul frein : le rapport de forces. On peut quasiment dire que tous les coups sont permis, et l’affaire Snowden l’a, d’une certaine façon, amplement démontré.
Pour autant, la France n’est pas la faible victime que certains Cassandre cherchent à dépeindre. Elle serait même réputée, notamment aux Etats-Unis, pour être particulièrement offensive, voire même redoutée, dans le domaine du renseignement économique…
Cela a été, en enquêtant, l’une de mes grandes surprises. Non seulement, la France n’a pas vocation à jouer les victimes mais, par le passé, elle a aussi fait preuve avec ses services d’une réelle audace, défiant sans crainte ni scrupule les grandes puissances et notamment les Etats-Unis. Ce n’est semble-t-il qu’une question de volonté politique. Quand cette volonté a existé (par exemple au début des années 80 puis au début des années 2000), elle a fait souffrir ses adversaires en s’emparant frauduleusement par exemple d’informations technologiques confidentielles, ou en faisant échouer certaines opérations hostiles à son « patrimoine » industriel stratégique. A-t-elle aujourd’hui encore cette pugnacité dans la recherche du renseignement ou pour contrer des offensives hostiles, je l’ignore.
Vous rapportez une anecdote stupéfiante. Au printemps 2010, Nicolas Sarkozy, alors Président de la République, aurait effectué un voyage éclair aux Etats-Unis afin de signer un accord secret visant à sceller, en présence de son homologue Barack Obama, un « pacte de non-espionnage réciproque ». Or, la France aurait essuyé ce jour-là un sérieux camouflet. Toujours pas de gentlemen’s agreement entre la CIA et la DGSE, donc ?
C’est vrai, Nicolas Sarkozy a cru que la France avec lui occupait une place privilégiée auprès de l’allié américain. Il s’est trompé. Sans doute s’est-il laissé abuser par ses conseillers spécialisés dans le Renseignement qui, eux-mêmes, ont sans doute manqué de réalisme et de sens politique, notamment en sous-estimant l’influence de la CIA et en pariant ingénument sur le coordinateur du renseignement américain. Cet homme n’était pas vraiment du sérail, et il était de surcroît à l’époque très controversé et engagé dans un bras de fer avec la CIA sur la question des opérations clandestines.
Par ailleurs la France n’entretient pas, comme la Grande Bretagne, de liens historiques intimes avec les services américains. Sur le fond, la situation n’a guère changé depuis. La France demeure certes un partenaire du premier rang mais elle n’a toujours pas un statut d’allié hors norme. Toutefois, dans le domaine de la « guerre technique » (écoutes, interceptions, intrusions, etc.), la DGSE et la NSA entretiennent aujourd’hui des relations qualifiées d’excellentes du fait, sans doute, que la France a accru ses « moyens techniques » et qu’elle aspire à jouer un rôle majeur dans la guerre du « renseignement électronique ».
Les guerres secrètes que vous décrivez ne se limitent pas au champ de l’espionnage. Leur autre versant serait la guerre d’influence que se livrent les nations et les grandes entreprises. Pouvez-vous nous citer un exemple permettant d’en cerner les enjeux ?
L’influence, c’est beaucoup de choses à la fois, un ensemble de mesures et de contre-mesures que l’on qualifie de « software ». Elle sert notamment à peser sur un choix ou une orientation, à influer dans une négociation ou encore à affaiblir son adversaire en le déstabilisant ou en le trompant. L’influence se marie souvent à des campagnes de presse, des opérations d’espionnage et d’écoutes classiques. Lorsqu’à Bruxelles, dans les années 90, les Américains ont contesté le concept « d’exception culturelle » afin de pousser leurs propres produits culturels sur le marché européen, les services français ont mené diverses opérations ayant pour but de dénoncer des alliances secrètes et cachées entre des hauts fonctionnaires et responsables politiques de l’Union européenne, et les représentants de l’industrie du spectacle américaine. En dénonçant ces connivences et la stratégie américaine, ils ont affaibli l’adversaire et ses actions de lobbying.
A la clé existait alors un enjeu commercial considérable. Souvenons-nous qu’avant la seconde guerre mondiale, le cinéma français représentait une énorme source de devises (et même une des principales) eu égard à son attractivité à l’étranger. L’influence c’est aussi faire capoter un contrat d’armement, en révélant par exemple dans la presse une opération de corruption que l’on a découverte par les moyens traditionnels de l’espionnage, et encore bien d’autres choses.
Le continent africain serait le théâtre d’une guerre d’influence acharnée entre la France et ses rivaux américain, israélien, chinois… Quelle est la réalité de la Françafrique, aujourd’hui ?
En termes de stricte influence, on peut dire que la « Françafrique » s’est contractée, ce qui signifie que nous sommes toujours très présents dans notre pré carré mais qu’il a fallu partager de gré ou de force avec d’autres concurrents, qui n’hésitent pas à contester les ressorts traditionnels de la « francophonie » et de ses réseaux.
Sur le plan militaire, inversement, en raison de la menace terroriste, notre présence - notamment celle des services secrets et des forces spéciales - s’est accrue d’autant que nos intérêts énergétiques (pétrole, gaz et uranium) dans la région exigent également une « protection » particulière et renforcée.
Le rôle croissant du secteur privé dans ces guerres souterraines a de quoi interpeller. Qui sont ces « privés » de la guerre économique ?
Vaste sujet… Disons que la sécurité privée et les officines de renseignement privées qui avaient le vent en poupe et pullulaient connaissent actuellement une situation de saturation et de concentration. Des groupes majeurs sont en train de se constituer, souvent sous l’égide de compagnies financières puissantes ou de grands groupes d’affaires. Elles emploient comme chacun sait d’anciens de la police, de la gendarmerie, des douanes ou encore des services secrets, et se sont structurées dans le cadre d’organisations professionnelles, objets de vigoureux enjeux de pouvoir, dont le top est le très influent et très côté « club des directeurs de sécurité des entreprises ».
Ces sociétés privées ne font pas ce qu’elles veulent. Officiellement, et par divers relais, elles sont toutes plus ou moins contrôlées ou surveillées par les services spéciaux français, DGSI et DGSE. Certaines d’entre elles peuvent malgré tout agir comme de simples officines.
A en croire l’issue de votre enquête, espions et manipulateurs sont aujourd’hui partout : fonds d’investissement, ONG, fondations, ambassades, grandes entreprises, centres de recherche… Est-il exagéré ou raisonnable de penser que tout interlocuteur est potentiellement un agent étranger?
Mon enquête a en effet révélé que l’ennemi, l’adversaire, le compétiteur résolu, qu’il s’agisse de très grandes entreprises ou d’Etats, ne recule devant aucun stratagème pour parvenir à ses fins. On sait, et pas seulement depuis la fuite de Snowden, que les agences de renseignement américaines ont violé les communications y compris les plus secrètes des autres Etats et même d’Etats alliés durant des décennies, grâce aux liens qu’elles entretenaient avec les grandes firmes de télécoms américaines ou encore grâce au système d’écoutes Echelon, créé au début de la guerre froide.
Des fonds d’investissement plus ou moins directement contrôlés par les services américains ont également racheté des sociétés aux activités sensibles. Par ce même canal, les services américains ont financé des recherches dans des domaines stratégiques comme celui des piles au lithium. Via le rachat de grandes compagnies d’assurances, les agences américaines, en faisant vibrer le patriotisme actionnarial des nouveaux propriétaires, ont pu faire discrètement main basse sur des banques de données phénoménales.
L’AID, l’agence américaine d’aide au développement, continue de servir de levier à la politique américaine dans les pays déshérités ou en voie de développement. Plusieurs rapports d’origines diverses ont établi le rôle plus qu’ambigu de certaines fondations ou ONG utilisées dans un rôle d’influence ou comme couverture pour des opérations de déstabilisation. N’oublions pas enfin cette incroyable directive d’Hilary Clinton, alors ministre des Affaires Etrangères de Barak Obama, datée du 31 juillet 2009 et adressée à la délégation diplomatique américaine à l’ONU. Hilary Clinton invitait ses membres à rassembler sur leurs collègues étrangers onusiens toutes sortes d’informations telles que leur ADN, leurs numéros de cartes de crédit ou bien les mots de passe de leur ordinateur, autant d’informations susceptibles d’être par la suite exploitées par les grandes agences de renseignement américaines.
D’après vous, qui avez tout de même rassemblé des milliers de documents secrets et avez interrogé bon nombre de ces acteurs clandestins de l’économie, quel sera le prochain pas franchi dans la guerre économique ?
Je ne lis pas dans le marc de café, mais on peut envisager une guerre des « clouds ». L’une des plus terribles hantises du monde financier serait en effet de voir disparaître les archives numériques des banques et autres institutions financières. On comprend aisément leur angoisse : quel système peut fonctionner sans mémoire ? Autre indiscutable maillon faible : le monde de l’Internet et ses « tuyaux », bien plus vulnérables qu’on ne le dit.

 Diplomatie
Diplomatie