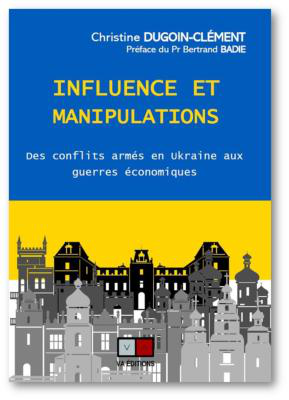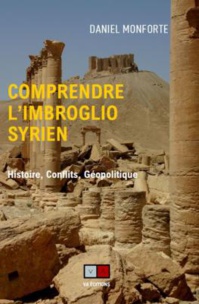Alors que le printemps arabe explosait en Tunisie à la toute fin de l’année 2010, à l’autre bout de la Méditerranée orientale un État était notoirement devenu stable : la Syrie. Les observateurs, Arabes comme Occidentaux, prédirent alors unanimement que l’incendie ne pouvait pas atteindre Damas. Les tensions qui avaient secoué cette nation depuis l’indépendance étaient apaisées. Les différentes communautés semblaient vivre en bonne intelligence. La situation économique progressait lentement, mais sûrement, avec un abandon progressif de l’Économie socialiste vers une libéralisation des marchés. La démocratie avançait aux petits pas du difficile consensus national, mais avançait vaille que vaille. Si bien que de tous les pays de cette région à fleur de peau, celui-ci comptait parmi les plus sûrs. D’ailleurs, la France de Sarkozy multipliait avec lui les projets de collaboration.
Pourtant quelques mois plus tard, c’est bien en Syrie que le printemps arabe connut son foyer le plus violent, en une guerre devenant rapidement parmi les plus longues et les plus meurtrières de la région. Comment un tel renversement de situation a-t-il été possible ?
Comme toujours lorsqu’une guerre éclate, les analystes occidentaux tentèrent d’esquisser à chaud quelques explications parmi les plus évidentes. Le printemps tunisien se serait propagé rapidement aux pays voisins, car la réussite d’une première révolution entraîne les suivantes. De fait, on observa bien l’effet de contagion, qui ébranla les pays arabes depuis le Maghreb à l’ouest jusqu’aux limites orientales à l’est, jusqu’aux confins du désert au sud. Les peuples en mal de démocratie étaient encouragés à se soulever à leur tour par la réussite de leurs voisins limitrophes. L’effet domino des révolutions successives était une allégorie aisée à comprendre. On ajouta pour le cas particulier de la Syrie que la révolte dégénérait en guerre civile pour la seule raison qu’un dictateur sanguinaire y tirait à balles réelles sur son propre peuple.
Rien de fondamentalement faux dans ces quelques raccourcis. Néanmoins, il était flagrant qu’il y avait là simplification à dégrossir. L’événement méritait que l’on s’y penchât plus en détail. Était-il possible que les choses aient été si simples, si binaires, qu’il existât à ce point un camp du Bien et un camp du Mal aussi clairement définis ? Est-il possible que Bachar el-Assad ne fût, et n’est encore aujourd’hui, rien d’autre que le tyran et l’assassin d’un peuple opprimé et pacifique ?
Si les communiqués de presse se doivent d’être synthétiques, il est indispensable d’adopter un format un peu plus vaste si l’on souhaite comprendre un sujet en profondeur. Embrasser un panorama qui tendrait davantage à l’exhaustivité.
Comprendre l’imbroglio syrien a pour objet de tenter cette approche, la plus complète possible des raisons ayant entraîné ce pays dans la guerre.
Le pays était apaisé, mais sous le couvercle pesant d’un pouvoir politique en place depuis 1970, le désir de changement était bien naturel. Et le refuser une atteinte évidente à la démocratie. Cependant, des massacres civils interethniques ou interreligieux faisant assez rapidement suite aux affrontements armés entre manifestants et forces de l’ordre, il était évident que la tournure prise ne pouvait plus s’expliquer que par la seule nécessité du changement. La grande marmite de cette nation très ancienne contenait encore quelques rancœurs, petites braises pas tout à fait éteintes de discordes passées et le déverrouillage du politique les ravivait.
Ainsi le printemps arabe ne se propageait pas ici en une rapide révolution comme en Tunisie, c’était bien le terme de guerre civile qui s’imposait. L’aggravation du mal semblait tout à fait endogène : un pouvoir politique trop autoritaire pour accepter la démocratie face à une nation trop hétérogène pour s’entendre.
Tenter de comprendre ces deux paramètres passait nécessairement par une analyse verticale de ce qui a conduit à pareille situation. Quel était donc ce Parti Baath intimement lié à la République arabe de Syrie et quelles étaient les composantes principales du peuple qui lui était soumis ?
La nation syrienne est d’une complexité rare, que nous tenterons de comprendre ici en remontant jusqu’aux sources les plus anciennes, quelques millénaires en arrière, temps où les racines de ce pays se confondent avec celles de l’Humanité tout entière. Entre Perse et Mésopotamie, l’écriture y apparait et se développe. De même que les religions modernes, qui abandonnent peu à peu le polythéisme et y inventent par schismes successifs les différents monothéismes connus dans leurs formes actuelles.
Les Syriens ont accompli cet exploit : constituer un peuple uni, bien que multiethnique, constitué des trois monothéismes principaux et de leurs innombrables courants. Cette hétérogénéité est une première difficulté, aggravée du fait politique. Les périodes d’indépendance politique sont rares dans son Histoire. Ce qui prédomine est bien davantage la succession interminable d’occupations étrangères. Constituer nation homogène dans ces conditions est une gageure. Dès l’indépendance acquise, en 1946, la problématique de la légitimité de la religion et de l’ethnie à placer au pouvoir se posa — elle reste d’actualité. Qui pour gouverner et organiser la paix sociale, le vivre ensemble le plus harmonieux, qui pour permettre le bonheur des Syriens ?
Derniers en date de ces occupants étrangers, les Ottomans et les Français illustrent par leur altérité cette composante majeure de la problématique syrienne : le destin tragique qui la pousse dans la guerre en 2011 a aussi des causes exogènes parce que ces terres ont toujours été et demeurent l’objet de toutes les convoitises.
Enjeu stratégique à l’échelon international, tout le Moyen-Orient est un lieu de lutte d’influence entre puissances locales et superpuissances. Ainsi, un changement du pouvoir politique à Damas ne peut pas intervenir sans que les uns et les autres ne tentent de tirer la couverture à soi.
À la verticalité historique vue précédemment, une approche plus horizontale s’impose donc : celle de la géopolitique contemporaine. Le conflit syrien ne peut pas se comprendre en effet sans la connaissance approfondie des enjeux stratégiques du moment et de leur histoire. Les projets politiques des puissances influentes sont incompatibles les uns avec les autres. Ils sont prompts eux aussi à générer des guerres.
Aujourd’hui plus encore qu’en 2011, les tensions internationales ont tout pour effrayer. Elles sont déjà en germes dans la guerre syrienne.
Depuis la crise des missiles de Cuba, jamais la rivalité entre les grandes puissances de ce monde n’avait approché d’aussi près l’affrontement direct. Parce que l’Ukraine est limitrophe de la Russie, le dérapage nucléaire est évoqué à tout moment. Sur un autre continent, l’Afrique, les puissances nucléaires s’affrontent encore, pour cette fois la maîtrise d’énergies primaires essentielles : le gaz et l’uranium du Niger. L’Afrique est au bord d’un affrontement international de grande ampleur, mais en toile de fond, ce sont bien l’Est et l’Ouest qui s’affrontent par proxys interposés.
L’Humanité entière observe avec impuissance et effroi ce grand retour de la guerre froide, alors qu’elle avait pensé que la chute du communisme reléguait cette situation à une période révolue. C’était une erreur ; la raison d’être de la guerre froide n’était pas qu’une divergence de vues sur l’économique. Non contentes d’être complexes, les causes d’un conflit sont souvent multiples.
En 2003, l’invasion de l’Irak par une coalition occidentale ne remportait pas l’adhésion que l’opération en Afghanistan deux ans plus tôt avait connue. Cette fois plusieurs voix s’élevèrent contre, dont deux du Conseil de sécurité de l’ONU : la Russie et la France. Si cette dernière rentra bien vite dans le rang, la Russie est demeurée dans le refus d’un monde entièrement dominé par Washington. Et pour cause, le printemps arabe renversait bon nombre de pays de l’ancien bloc soviétique. L’aide occidentale aux révolutionnaires de ce printemps était vue par Moscou comme une ingérence, la chute de ses alliés comme un émiettement de son influence dans le monde. Puis lorsque le danger atteignit Damas et Téhéran, la perspective de ces nouveaux basculements fut, à tort ou à raison, considérée par Moscou comme une menace existentielle.
Si bien que le prisme géopolitique nous fait observer que les circonstances de ces deux guerres, l’ukrainienne et la syrienne, n’ont de différences que dans les contingences locales particulières vues plus haut. Les peuples d’Europe de l’Ouest ne sont pas ceux du Moyen-Orient, les revendications populaires postsoviétiques en Europe de l’Est ne sont pas celles des révolutions arabes. Mais dans les deux cas, la guerre est aussi déclenchée parce que le camp occidental pousse ces pays vers une gouvernance à l’occidentale et que le camp oriental refuse catégoriquement pareil sens de l’Histoire.
Enfin, la géopolitique ne se résume pas à la rivalité entre superpuissances. Les États voisins ou courants politiques locaux eurent aussi leurs propres intérêts dans le maintien ou dans la chute annoncée de Bachar el-Assad.
La création de l’État d’Israël est concomitante de l’indépendance syrienne ; les deux jeunes États se sont copieusement détestés et combattus, mais si la situation se détendait entre eux, leur rivalité s’est maintenue par un enjeu local : le contrôle du Liban. Le Hezbollah, force politique et militaire soutenue par Téhéran, y est aussi très présent. Il s’est engagé en force d’appoint auprès des forces loyalistes syriennes, car sauvegarder l’allié baathiste est pour lui comme pour l’Iran, vital.
À l’inverse, les pétromonarchies voisines ont soutenu les rebelles. Aux premiers rangs desquels l’Arabie Saoudite et le Qatar. Ils ne furent pas les plus rétifs à un recul de la laïcité en terre arabe.
La Turquie, qui partage avec Damas un vieux contentieux de frontière et de population, notamment l’indépendantisme kurde, vit quant à elle une opportunité d’avancer sur son propre agenda. Le Président Erdogan n’échappe pas à la tentation, comme de l’autre côté les partisans de la Grande Syrie, à un certain irrédentisme.
Force de l’islam politique sunnite, les Frères musulmans se sont imposés comme l’opposition principale, dès la prise de pouvoir du parti Baath en 1963. Leur rôle est déterminant à plus d’un titre. En premier lieu parce qu’un État socialiste et laïque est à l’opposé absolu de leur projet politique. Ensuite parce qu’ils sont historiquement un allié régulier des États-Unis. Enfin parce qu’Al-Qaïda compte bon nombre d’anciens Frères dans ses rangs. Aussi, l’instrumentalisation du fait religieux dans l’insurrection de 2011 ne doit pas être occultée. D’autant que l’opposition des Frères en Syrie connut dans le passé des précédents violents. Le camp occidental s’est engagé auprès des révolutionnaires les plus fervents, mais certains de ces combattants sont devenus incontrôlables. Ils se sont révélés être les futurs fondateurs de l’État islamique d’Irak et de Syrie, poussant les pays de l’OTAN à intervenir contre ceux-là mêmes qu’ils avaient précédemment armés.
Pourtant quelques mois plus tard, c’est bien en Syrie que le printemps arabe connut son foyer le plus violent, en une guerre devenant rapidement parmi les plus longues et les plus meurtrières de la région. Comment un tel renversement de situation a-t-il été possible ?
Comme toujours lorsqu’une guerre éclate, les analystes occidentaux tentèrent d’esquisser à chaud quelques explications parmi les plus évidentes. Le printemps tunisien se serait propagé rapidement aux pays voisins, car la réussite d’une première révolution entraîne les suivantes. De fait, on observa bien l’effet de contagion, qui ébranla les pays arabes depuis le Maghreb à l’ouest jusqu’aux limites orientales à l’est, jusqu’aux confins du désert au sud. Les peuples en mal de démocratie étaient encouragés à se soulever à leur tour par la réussite de leurs voisins limitrophes. L’effet domino des révolutions successives était une allégorie aisée à comprendre. On ajouta pour le cas particulier de la Syrie que la révolte dégénérait en guerre civile pour la seule raison qu’un dictateur sanguinaire y tirait à balles réelles sur son propre peuple.
Rien de fondamentalement faux dans ces quelques raccourcis. Néanmoins, il était flagrant qu’il y avait là simplification à dégrossir. L’événement méritait que l’on s’y penchât plus en détail. Était-il possible que les choses aient été si simples, si binaires, qu’il existât à ce point un camp du Bien et un camp du Mal aussi clairement définis ? Est-il possible que Bachar el-Assad ne fût, et n’est encore aujourd’hui, rien d’autre que le tyran et l’assassin d’un peuple opprimé et pacifique ?
Si les communiqués de presse se doivent d’être synthétiques, il est indispensable d’adopter un format un peu plus vaste si l’on souhaite comprendre un sujet en profondeur. Embrasser un panorama qui tendrait davantage à l’exhaustivité.
Comprendre l’imbroglio syrien a pour objet de tenter cette approche, la plus complète possible des raisons ayant entraîné ce pays dans la guerre.
Le pays était apaisé, mais sous le couvercle pesant d’un pouvoir politique en place depuis 1970, le désir de changement était bien naturel. Et le refuser une atteinte évidente à la démocratie. Cependant, des massacres civils interethniques ou interreligieux faisant assez rapidement suite aux affrontements armés entre manifestants et forces de l’ordre, il était évident que la tournure prise ne pouvait plus s’expliquer que par la seule nécessité du changement. La grande marmite de cette nation très ancienne contenait encore quelques rancœurs, petites braises pas tout à fait éteintes de discordes passées et le déverrouillage du politique les ravivait.
Ainsi le printemps arabe ne se propageait pas ici en une rapide révolution comme en Tunisie, c’était bien le terme de guerre civile qui s’imposait. L’aggravation du mal semblait tout à fait endogène : un pouvoir politique trop autoritaire pour accepter la démocratie face à une nation trop hétérogène pour s’entendre.
Tenter de comprendre ces deux paramètres passait nécessairement par une analyse verticale de ce qui a conduit à pareille situation. Quel était donc ce Parti Baath intimement lié à la République arabe de Syrie et quelles étaient les composantes principales du peuple qui lui était soumis ?
La nation syrienne est d’une complexité rare, que nous tenterons de comprendre ici en remontant jusqu’aux sources les plus anciennes, quelques millénaires en arrière, temps où les racines de ce pays se confondent avec celles de l’Humanité tout entière. Entre Perse et Mésopotamie, l’écriture y apparait et se développe. De même que les religions modernes, qui abandonnent peu à peu le polythéisme et y inventent par schismes successifs les différents monothéismes connus dans leurs formes actuelles.
Les Syriens ont accompli cet exploit : constituer un peuple uni, bien que multiethnique, constitué des trois monothéismes principaux et de leurs innombrables courants. Cette hétérogénéité est une première difficulté, aggravée du fait politique. Les périodes d’indépendance politique sont rares dans son Histoire. Ce qui prédomine est bien davantage la succession interminable d’occupations étrangères. Constituer nation homogène dans ces conditions est une gageure. Dès l’indépendance acquise, en 1946, la problématique de la légitimité de la religion et de l’ethnie à placer au pouvoir se posa — elle reste d’actualité. Qui pour gouverner et organiser la paix sociale, le vivre ensemble le plus harmonieux, qui pour permettre le bonheur des Syriens ?
Derniers en date de ces occupants étrangers, les Ottomans et les Français illustrent par leur altérité cette composante majeure de la problématique syrienne : le destin tragique qui la pousse dans la guerre en 2011 a aussi des causes exogènes parce que ces terres ont toujours été et demeurent l’objet de toutes les convoitises.
Enjeu stratégique à l’échelon international, tout le Moyen-Orient est un lieu de lutte d’influence entre puissances locales et superpuissances. Ainsi, un changement du pouvoir politique à Damas ne peut pas intervenir sans que les uns et les autres ne tentent de tirer la couverture à soi.
À la verticalité historique vue précédemment, une approche plus horizontale s’impose donc : celle de la géopolitique contemporaine. Le conflit syrien ne peut pas se comprendre en effet sans la connaissance approfondie des enjeux stratégiques du moment et de leur histoire. Les projets politiques des puissances influentes sont incompatibles les uns avec les autres. Ils sont prompts eux aussi à générer des guerres.
Aujourd’hui plus encore qu’en 2011, les tensions internationales ont tout pour effrayer. Elles sont déjà en germes dans la guerre syrienne.
Depuis la crise des missiles de Cuba, jamais la rivalité entre les grandes puissances de ce monde n’avait approché d’aussi près l’affrontement direct. Parce que l’Ukraine est limitrophe de la Russie, le dérapage nucléaire est évoqué à tout moment. Sur un autre continent, l’Afrique, les puissances nucléaires s’affrontent encore, pour cette fois la maîtrise d’énergies primaires essentielles : le gaz et l’uranium du Niger. L’Afrique est au bord d’un affrontement international de grande ampleur, mais en toile de fond, ce sont bien l’Est et l’Ouest qui s’affrontent par proxys interposés.
L’Humanité entière observe avec impuissance et effroi ce grand retour de la guerre froide, alors qu’elle avait pensé que la chute du communisme reléguait cette situation à une période révolue. C’était une erreur ; la raison d’être de la guerre froide n’était pas qu’une divergence de vues sur l’économique. Non contentes d’être complexes, les causes d’un conflit sont souvent multiples.
En 2003, l’invasion de l’Irak par une coalition occidentale ne remportait pas l’adhésion que l’opération en Afghanistan deux ans plus tôt avait connue. Cette fois plusieurs voix s’élevèrent contre, dont deux du Conseil de sécurité de l’ONU : la Russie et la France. Si cette dernière rentra bien vite dans le rang, la Russie est demeurée dans le refus d’un monde entièrement dominé par Washington. Et pour cause, le printemps arabe renversait bon nombre de pays de l’ancien bloc soviétique. L’aide occidentale aux révolutionnaires de ce printemps était vue par Moscou comme une ingérence, la chute de ses alliés comme un émiettement de son influence dans le monde. Puis lorsque le danger atteignit Damas et Téhéran, la perspective de ces nouveaux basculements fut, à tort ou à raison, considérée par Moscou comme une menace existentielle.
Si bien que le prisme géopolitique nous fait observer que les circonstances de ces deux guerres, l’ukrainienne et la syrienne, n’ont de différences que dans les contingences locales particulières vues plus haut. Les peuples d’Europe de l’Ouest ne sont pas ceux du Moyen-Orient, les revendications populaires postsoviétiques en Europe de l’Est ne sont pas celles des révolutions arabes. Mais dans les deux cas, la guerre est aussi déclenchée parce que le camp occidental pousse ces pays vers une gouvernance à l’occidentale et que le camp oriental refuse catégoriquement pareil sens de l’Histoire.
Enfin, la géopolitique ne se résume pas à la rivalité entre superpuissances. Les États voisins ou courants politiques locaux eurent aussi leurs propres intérêts dans le maintien ou dans la chute annoncée de Bachar el-Assad.
La création de l’État d’Israël est concomitante de l’indépendance syrienne ; les deux jeunes États se sont copieusement détestés et combattus, mais si la situation se détendait entre eux, leur rivalité s’est maintenue par un enjeu local : le contrôle du Liban. Le Hezbollah, force politique et militaire soutenue par Téhéran, y est aussi très présent. Il s’est engagé en force d’appoint auprès des forces loyalistes syriennes, car sauvegarder l’allié baathiste est pour lui comme pour l’Iran, vital.
À l’inverse, les pétromonarchies voisines ont soutenu les rebelles. Aux premiers rangs desquels l’Arabie Saoudite et le Qatar. Ils ne furent pas les plus rétifs à un recul de la laïcité en terre arabe.
La Turquie, qui partage avec Damas un vieux contentieux de frontière et de population, notamment l’indépendantisme kurde, vit quant à elle une opportunité d’avancer sur son propre agenda. Le Président Erdogan n’échappe pas à la tentation, comme de l’autre côté les partisans de la Grande Syrie, à un certain irrédentisme.
Force de l’islam politique sunnite, les Frères musulmans se sont imposés comme l’opposition principale, dès la prise de pouvoir du parti Baath en 1963. Leur rôle est déterminant à plus d’un titre. En premier lieu parce qu’un État socialiste et laïque est à l’opposé absolu de leur projet politique. Ensuite parce qu’ils sont historiquement un allié régulier des États-Unis. Enfin parce qu’Al-Qaïda compte bon nombre d’anciens Frères dans ses rangs. Aussi, l’instrumentalisation du fait religieux dans l’insurrection de 2011 ne doit pas être occultée. D’autant que l’opposition des Frères en Syrie connut dans le passé des précédents violents. Le camp occidental s’est engagé auprès des révolutionnaires les plus fervents, mais certains de ces combattants sont devenus incontrôlables. Ils se sont révélés être les futurs fondateurs de l’État islamique d’Irak et de Syrie, poussant les pays de l’OTAN à intervenir contre ceux-là mêmes qu’ils avaient précédemment armés.

 Diplomatie
Diplomatie