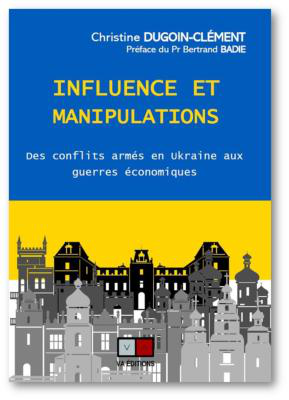Comment percevez-vous l’évolution de la culture de sécurité au fil des décennies ?
Nous pouvons nous indigner du manque de militarité au sein de nos institutions qui ferait de nos nouvelles recrues des gens faibles, sans force mentale. Mais Végèce, général romain du IVe siècle s’indignait déjà que les jeunes soldats étaient réticents au port du casque, de la cuirasse et des armes, car étant trop pesants, que la paresse et la négligence rendaient les exercices moins fréquents. En réalité, la notion de performance opérationnelle a très largement augmenté ces dernières années. De l’individu au collectif, il est possible de constater que les performances individuelles (physiques) sont bien plus élevées aujourd’hui qu’il y a 30 ans lors des concours d’entrée dans nos institutions. Au niveau de l’individu toujours, il serait particulièrement intéressant d’étudier la part de facteur humain intrinsèque dans les capacités mentales à faire face à des situations extrêmes. Là où une grande résilience est nécessaire pour supporter les charges mentales liées à de tels métiers. À ce jour, il n’existe pas d’études sur ce sujet. Collectivement nous sommes toutefois bien mieux armés pour faire face à nos missions. La culture de sécurité a véritablement évolué et nous sommes bien mieux protégés que nos ainés. Meilleurs matériels, meilleures procédures, une véritable anticipation des risques, des modes d’action plus clairs et mieux définis. Il existe aujourd’hui des processus de gestion des risques qui permettent de prendre en compte l’ensemble des situations à risque.
Cette culture de sécurité, ou culture du risque s’est largement étendue vers l’entreprise où il est désormais devenu obligatoire de prendre en compte l’ensemble des risques en matière de sécurité par les employeurs dont le souci de rentabilité financière se serait passé volontiers. La sécurité intérieure quant à elle n’a pas vocation à être financièrement rentable, seule l’atteinte des objectifs opérationnels permet de dépasser les contraintes, d’aller au-delà du risque.
Votre texte aborde la question du respect mutuel dans les métiers de la sécurité intérieure et chez les soignants. Comment définiriez-vous le concept de respect dans ce contexte, et comment cela se traduit-il en termes de hiérarchie, de discipline, et d’interactions quotidiennes ?
S’il fallait parler de respect au sein des professions de la sécurité intérieure ou chez les soignants, il s’agirait de définir trois axes.
Le premier, très global, est celui du respect de son institution. Les valeurs qu’elle porte, les missions qu’elle remplit, ses engagements dans sa notion de service public. Il existe chez ceux qui s’engagent une profonde dévotion envers son institution dans son échelle philosophique. Je m’explique. Les pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires, les médecins, les infirmières, tous s’engagent avec un profond respect envers l’idée de sauver des vies, envers la noblesse de la tâche que porte son entité d’appartenance. Cela ne veut pas dire qu’il y a nécessairement du respect envers son employeur ou son directeur de service. Cette première forme de respect est de l’ordre de la mystique envers une œuvre qui est au-delà des considérations humaines.
Le deuxième axe est celui du respect de ses collègues, de ses frères et sœurs d’armes. Le respect de ceux avec qui nous devons faire face à l’impensable, à l’inacceptable, face à la mort parfois. Il se crée au sein de nos métiers un lien indéfectible qui donne à nos relations interhumaines une particularité singulière. Lorsque vous vivez ensemble dans ces microcosmes sociaux où vous devez constamment affronter une adversité extérieure, vos relations aux collègues changent. C’est un lien très fort et empreint de respect. Attention, il ne faut pas s’y tromper non plus, ce n’est pas un monde paradisiaque où tout le monde s’aime et s’entraide, non. Il y a des tensions interhumaines, des conflits qui sont d’ailleurs souvent exacerbés par cet environnement hostile, mais en mission, il n’y a pas de place pour les conflits. C’est une forme de respect.
Enfin, troisièmement, il y a le respect envers ceux auprès de qui nous intervenons. Cette notion est fondamentale dans nos métiers, car elle nous oblige. Nous devons traiter chaque personne, chaque victime, chaque malade, mais aussi chaque contrevenant comme s’il était un membre de notre propre famille, avec respect et considération. Nous ne sommes pas juge, jamais, d’aucune façon. Notre travail consiste à aider, à soigner, parfois à réprimer, mais toujours sans jugement. Dans l’immense majorité des cas, les choses se passent bien, mais malheureusement, certains d’entre nous ne respectent pas cette règle et deviennent l’objet de tous les regards. Il est tellement inadmissible, en République, que des agents transgressent les règles, les valeurs de Liberté, d’Égalité ou de Fraternité qu’à chaque écart, la presse et les médias s’en saisissent.
En matière de « management du respect », les règles hiérarchiques sont établies, strictes et figées et ne souffrent d’aucune forme d’aménagement. Le facteur humain entre encore une fois en considération dans le lien que les acteurs de la sécurité intérieure ou les soignants ont avec leurs hiérarchies respectives. Il y a ces chefs que l’on pourrait suivre jusqu’au bout du monde et puis il y a les autres. Comme tous mes camarades, dans ma carrière il m’est arrivé de croiser des chefs qui n’avaient eux même pas le moindre respect envers leurs Hommes, la réciprocité a toujours été de mise. Un chef qui ne respecte pas ceux qu’il dirige ne doit s’attendre à rien d’autre en retour que mépris, haine, arrogance ou démotivation.
Le texte aborde les impacts psychologiques de ces vies d’engagement au service des autres. Comment les armées modernes prennent en compte et gèrent ces aspects, et comment cela se reflète dans la culture militaire globale ?
Il y a d’une part les traumatismes psychologiques dits « secondaires » avec des symptômes de troubles anxieux, de dépression, de syndromes psychotraumatiques par exemple, pour lesquels la prévention et la prise en charge a nettement évoluée au sein de nos professions. La grande majorité des situations potentiellement traumatisantes restent toutefois gérées sans faire appel à un intervenant extérieur. Pour les profanes, il faut noter que les situations où nous faisons face à l’horreur, à la souffrance, à la mort, c’est chaque jour. Je ne dis pas que nous nous habituons, mais nous nous « densifions » pour reprendre le terme du docteur Gérard CHAPUT dans son ouvrage « La densification de l’être », nous devenons moins perméables à un quotidien dans lequel nous mettons les mains, là où la plupart des gens ne mettraient pas les yeux.
En matière de modernité, le numérique a éloigné le soldat du champ de bataille. Lorsqu’un militaire actionne la lancée d’un missile depuis un écran d’ordinateur, nous ne sommes plus sur un combat où les baïonnettes venaient éventrer l’ennemi. Les armées ont toutefois mis en œuvre des systèmes de surveillance pour veiller à la sécurité psychologique de leurs membres, car même lorsque la mort est donnée à distance, ce n’est pas un acte sans conséquences psychologiques.
D’autre part, il y a ce que l’on appelle le traumatisme vicariant. Moins connu, il résulte de l’empathie qu’un professionnel ressent à l’égard de la personne en souffrance. La transformation intérieure entraînée par le trauma vicariant peut être négative ou positive. Les soignants, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires qui écoutent les récits des victimes parfois dramatiques, mais les travailleurs humanitaires et les journalistes-reporters travaillant dans des pays en guerre, ainsi que les travailleurs sociaux et les éducateurs côtoyant au quotidien des victimes de situations précaires et de violences, sont eux aussi touchés par ce phénomène. S’il y a des conséquences positives comme la prise de sens dans sa mission, on y retrouve à l’inverse le burn-out, le rejet des victimes dans un sentiment de saturation, le phénomène de rupture avec son entourage personnel et professionnel ainsi que des émotions exacerbées. C’est aussi le message en fil rouge de ce livre, la confrontation à la souffrance permanente a tendance à rendre nos professionnels moins naïfs quant à la sûreté et la bonté du monde. J’utilise souvent le mot « déniaiser » pour décrire ce que provoquent nos professions chez les plus jeunes.

 Diplomatie
Diplomatie